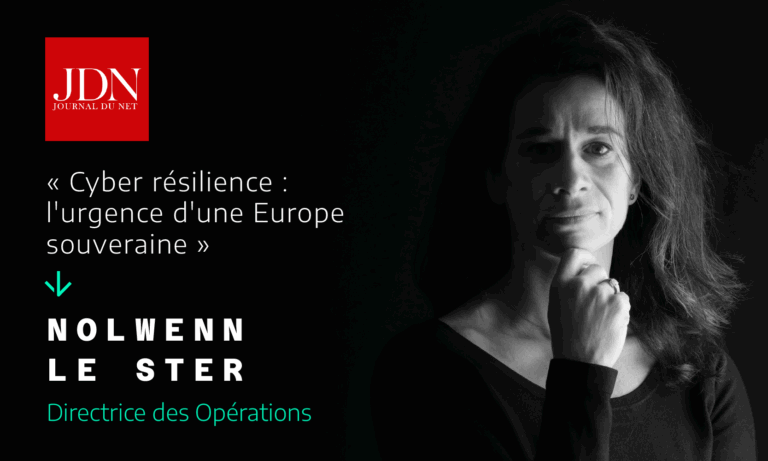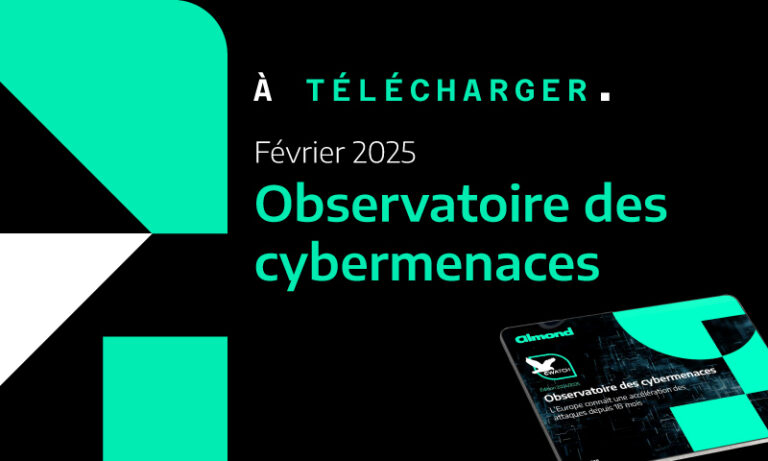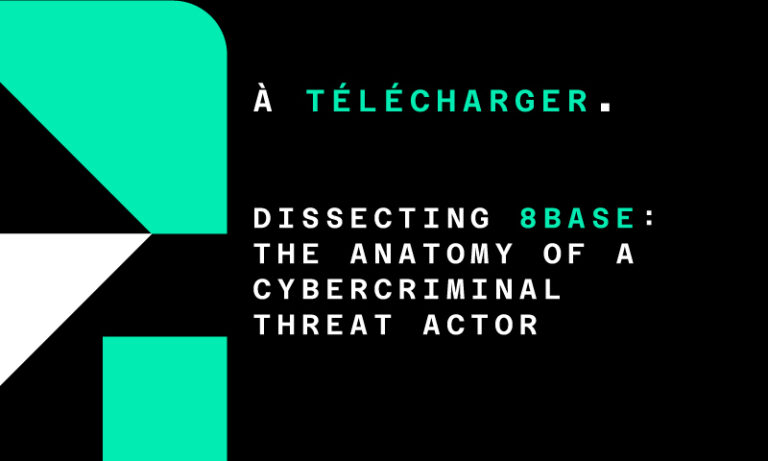16/07/2025
Cybersecurity Insights
Cybersécurité spatiale : un enjeu stratégique au cœur de notre souveraineté numérique
De la météo à la géolocalisation, des télécommunications à la défense, nos infrastructures spatiales sont devenues un incontournable de notre économie, nos armées, nos vies. Derrière cette dépendance croissante se cache une menace : les attaques cyber qui visent ces infrastructures. Les satellites deviennent des cibles, les orbites une nouvelle surface d’attaque et la cyber résilience un impératif stratégique. Les systèmes spatiaux, au sol comme en orbite, sont eux aussi numériques, donc vulnérables. Segments sols, liaisons de données, supply chain, etc. : autant de points d’entrée pour des acteurs malveillants cherchant à perturber, espionner, détourner ou neutraliser des services critiques. Des puissances étrangères l’ont déjà démontré.
Cet article explore les dynamiques et les enjeux du secteur spatial et de la cybersécurité à travers leur interdépendance croissante ainsi que le développement réglementaire et technologique. Il examine également l’évolution des menaces dans un contexte de tension géopolitique accrue. Longtemps réservé à un cercle restreint de puissances étatiques, l’espace connaît aujourd’hui une ouverture sans précédent à une diversité croissante d’acteurs. Si la guerre froide avait instauré une course aux étoiles dominée par quelques États privilégiés, l’ère actuelle, marquée par l’hyperconnectivité et l’essor de l’intelligence artificielle (IA), bouleverse cette dynamique. L’accès à l’espace n’est plus l’exclusive prérogative des seules puissances publiques : le secteur privé y prend désormais une place déterminante, redéfinissant les équilibres stratégiques et économiques.
Depuis l’ère de la guerre froide, l’espace est à la fois un champ de rivalité et un indicateur de force, où les pays se disputent pour démontrer leur prépondérance technologique et stratégique. Cette compétition ne se déroule pas uniquement au-delà de l’atmosphère terrestre : sur Terre, l’avancée de technologies cruciales telles qu’Internet ou encore l’IA a radicalement modifié les dynamiques géopolitiques et de sécurité internationale. Ces progrès, initialement développés pour des applications civiles et militaires sur terre sont désormais étroitement liés au secteur spatial. La frontière entre espace et cyberespace devient de plus en plus floue : ce sont des domaines ouverts, partagés, transfrontaliers, tous deux utilisés à des fins militaires, civiles et commerciales.[1] Cette intersection témoigne de l’enjeu crucial que représente la cybersécurité spatiale. Il devient ainsi impératif de repenser les mécanismes traditionnels de protection et de résilience, afin d’assurer la souveraineté et la sécurité des infrastructures spatiales contre les attaques cyber.
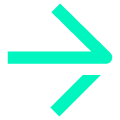
Les enjeux de la cybersécurité spatiale
Selon le Général Adam, Commandant de l’Espace, l’événement de 2018 a révélé une potentielle agressivité dans l’espace, ce qui en a fait un élément fondateur dans la prise de conscience des enjeux de sécurité spatiale. Ainsi, le Commandement de l’espace a été créé en septembre 2019, à la suite de la publication de la stratégie spatiale de défense de France en juillet 2019. Pour le Général Adam, « la guerre dans l’espace, on la voit venir » : une formule qui résume l’évidence croissante d’un risque majeur. La guerre ne sera pas forcément dans l’espace mais pour l’espace selon lui.[3] Loin d’être un scénario futuriste, le spatial est désormais un domaine exposé à des menaces bien réelles, actuelles et stratégiquement critiques.
Pendant longtemps, la menace spatiale a été principalement envisagée sous l’angle cinétique : des missiles sol capables de détruire un satellite en orbite (ASAT) ou des collisions provoquées volontairement. Ce type d’attaque a un inconvénient majeur : il génère des débris qui polluent durablement les orbites et peuvent endommager d’autres satellites, y compris ceux de l’attaquant. Aujourd’hui, les formes modernes de guerre spatiales sont plus discrètes et parfois plus efficaces. Cette réalité confirme ce que le Général Adam résume en une phrase lors de son interview avec le média Brut : « Une cyberattaque bien ciblée peut supprimer toute une capacité spatiale. »
L’accélération de la numérisation des systèmes spatiaux trouve son origine dans la transition des engins spatiaux, passés de l’électronique analogique à des systèmes numérisés.[4] En conséquence, de nombreuses opérations spatiales passent de la couche physique à la couche logicielle du cyberespace. Cette connectivité croissante expose les systèmes spatiaux aux cyberattaques et augmente la surface d’attaque.[5] L’exemple des constellations de nanosatellites illustre bien cette évolution : fonctionnant en réseau, ces satellites échangent constamment des données entre eux et avec le sol, rendant l’ensemble du système plus performant, mais aussi plus vulnérable aux cybermenaces. Plus largement, c’est l’ensemble du secteur spatial qui s’est engagé dans cette numérisation progressive, exposant davantage ses infrastructures aux risques cyber. Dans le cadre d’un exercice mis en place par l’Agence spatiale européenne (ESA) en 2023, des spécialistes en sécurité informatique de Thales ont réussi à prendre le contrôle du nanosatellite OPS-SAT.[6] Cet exercice de hacking a exposé les faiblesses éventuelles des systèmes spatiaux face aux attaques informatiques, mettant l’accent sur l’importance d’améliorer leur capacité de résistance.
Ce n’est que récemment que la militarisation de l’espace a commencé à être envisagée sous l’angle de la cybersécurité avec la reconnaissance officielle des attaques cyber pesant sur les systèmes spatiaux dans les politiques spatiales (UE, 2016 ; France, 2019 ; Estonie, 2020 ; Royaume-Uni, 2021).[7] Si la militarisation de l’espace, centrée sur le déploiement et l’utilisation d’armes dans l’espace, reste une tendance croissante, cette approche ne suffit plus à rendre compte de la complexité des enjeux contemporains, notamment avec l’arrivée du cyberespace comme nouveau champ de confrontation.[8] Désormais, l’attention se porte également sur l’usage d’infrastructures spatiales privées, telles que les constellations de satellites, dans des contextes de conflit international. Bien que d’origine civile, ces systèmes possèdent souvent une nature duale, dite « dual-use » et peuvent ainsi être détournés à des fins militaires. Ainsi, ils peuvent devenir des éléments cruciaux pour des opérations militaires, soulevant de nouvelles interrogations juridiques. Sur le plan européen, le système Galileo illustre cette dimension duale avec la mise en place du Public Regulated Service (PRS) conçu pour garantir des communications sécurisées aux autorités publiques, y compris en cas de crise ou de conflit.[9] Ce lien entre infrastructures spatiales civiles et objectifs militaires met en lumière l’importance croissante de la cybersécurité dans l’élaboration des politiques spatiales contemporaines.
Un exemple concret de la vulnérabilité des infrastructures spatiales face aux cybermenaces, avec des implications directes pour la souveraineté européenne, est la cyberattaque contre le satellite Viasat KA-SAT au début de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Cet incident a mis en évidence non seulement la fragilité des satellites face aux attaques numériques, mais aussi les enjeux géopolitiques majeurs liés à la cybersécurité spatiale.[10] Le but de l’attaque était d’empêcher l’Ukraine d’utiliser l’espace pour réagir à l’invasion, mais elle a aussi eu des conséquences à travers toute l’Europe, touchant des milliers de civils sur le continent, y compris des infrastructures essentielles.[11] Le Général de division aérienne Michel Friedling, du Commandement de l’espace, avait notamment confirmé lors du point Presse du ministère des Armées du jeudi 3 mars 2022, qu’un réseau satellitaire qui couvre notamment l’Europe et l’Ukraine a été victime d’une attaque cyber avec des dizaines de milliers de terminaux rendus inopérants.[12] Dans un rapport publié en octobre 2022, la European Space Policy Institute (ESPI) a par ailleurs souligné : « Dans la communauté spatiale, la cyberattaque KA-SAT a soulevé un débat plus large sur la cybersécurité des systèmes spatiaux et la protection des infrastructures critiques ».[13] Cette cyberattaque a mis en évidence l’importance cruciale de la cybersécurité dans le domaine spatial et la nécessité d’accroître la collaboration européenne afin de préserver ces infrastructures essentielles face à des menaces en constante augmentation.
La dépendance croissante aux services spatiaux est de plus en plus marquée. Si les infrastructures de communication traditionnelles reposaient essentiellement sur des câbles sous-marins réputés robustes, ceux-ci ont prouvé leur vulnérabilité physique face à des incidents (interventions de navires, attaques animales, etc.). Aujourd’hui, l’essor des mégaconstellations, comme Starlink ou le projet Kuiper d’Amazon, marque une nouvelle ère : celle d’une couverture Internet mondiale via des milliers de satellites en orbite basse (LEO). Mais cette évolution entraîne un élargissement considérable de la surface d’attaque. Chaque satellite et station sol devient un point d’entrée potentiel pour des attaques informatiques, avec des risques accrus d’interception, de brouillage, voire d’espionnage électronique. Comme ces satellites sont pilotés par des firmwares et des logiciels embarqués, une cyberattaque bien ciblée pourrait compromettre l’ensemble d’un réseau.
Dans une interview accordée à L’Usine Digitale, Laurent Jaffart, Directeur de la Connectivité et des Communications Sécurisées à l’ESA revient sur les principales techniques mises en œuvre pour renforcer la sécurité des satellites.[14] Il insiste d’abord sur la nécessité de limiter leur exposition à des réseaux vulnérables. Une isolation totale n’étant pas réaliste pour les télécommunications, une séparation stricte est instaurée entre l’exploitation du satellite et celle du réseau, afin de contenir les risques en cas d’attaque. Avec la montée en puissance des Software-Defined Satellites, de plus en plus pilotés par logiciel, la cybersécurité repose aussi sur un développement rigoureux et une validation continue du code embarqué, incluant des tests face aux menaces connues comme aux vulnérabilités émergentes. À cela s’ajoute la sécurisation indispensable des infrastructures au sol, tant sur le plan physique que logique. Enfin, il évoque les menaces militaires, comme la destruction d’un satellite russe par missile au début du conflit en Ukraine, qui soulève la problématique des débris spatiaux. Dans un environnement international et interconnecté comme l’espace, la pollution n’est jamais locale : la sécurité dépend donc aussi d’une gouvernance internationale et d’un engagement collectif en faveur de comportements responsables.
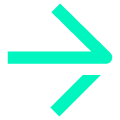
Souveraineté et territoire en cybersécurité spatiale
Cependant, suite au lancement de Spoutnik en 1957, le premier engin placé en orbite autour de la Terre, la question de savoir si des États souverains pourraient exprimer leurs préoccupations concernant la possibilité qu’un objet potentiellement dangereux traverse leurs frontières respectives s’est posée.[17] En vertu du principe de non-ingérence, les États doivent être en mesure de contrôler leurs propres affaires pour éviter l’ingérence extérieure et pouvoir revendiquer légalement leurs souverainetés. De plus, l’article 2(1) de la Charte des Nations Unies dispose que celle-ci est basée sur le principe de l’égalité souveraine de tous ses membres, cela implique que chaque État a le droit de contrôler ses affaires internes sans ingérence extérieure.[18] L’incapacité d’exercer un contrôle effectif et durable sur le territoire concerné a ainsi joué un rôle fondamental dans la ratification de l’article II.[19]
L’article I du Traité de l’espace dispose que « L’exploration et l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, doivent se faire pour le bien et dans l’intérêt de tous les pays, quel que soit le stade de leur développement économique ou scientifique ; elles sont l’apanage de l’humanité tout entière », ce qui réaffirme le principe de libre accès et d’utilisation pacifique de l’espace.[20] Cependant, le nombre croissant d’entreprises privées s’engageant dans l’exploitation de l’espace soulève la question de la régulation et de la responsabilité des activités spatiales privées.
L’une des menaces les plus préoccupantes pour les satellites sont les cyberattaques, qui peuvent avoir des effets catastrophiques et un impact sur l’ensemble de la planète si elles ne visent qu’un seul satellite. En droit de l’espace, l’article couvrant les règles de responsabilité des États est l’article VI du traité de l’Espace qui dispose que « Les États parties au Traité ont la responsabilité internationale des activités nationales dans l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, […] conformément aux dispositions énoncées dans le présent Traité ».[21] Une activité spatiale nationale est définie comme une activité menée par l’État, par un ressortissant d’un État, qui a un lien territorial avec un État ou qui lui est attribuable d’une autre manière, conformément à la règle 102 du Manual on International Law Applicable to Military Uses of Outer Space (MILAMOS).[22] Cette obligation est décrite dans la règle 123 comme la nécessité d’approuver et de superviser en permanence les opérations spatiales non gouvernementales.[23] L’une des limites des cyberattaques sont qu’elles sont effectuées depuis la terre et donc « sur le terrain », elles ne sont donc pas en tant que telles des « activités spatiales ». Le droit de l’espace couvre les activités spatiales dans l’espace ou liées à l’espace qui sont menées pour l’un des quatre objectifs suivants : l’exploration de l’espace, le développement des technologies spatiales, les applications spatiales et la mise en œuvre des résultats de l’exploration de l’espace et des technologies spatiales.[24]
Face à ces enjeux, il devient essentiel d’adapter les stratégies de cyberdéfense afin de répondre aux spécificités du contexte spatial. Cela implique le développement de capacités de défense adaptées, à travers un renforcement des législations et une collaboration accrue entre les acteurs du secteur. Dans cette perspective, la coopération européenne apparaît comme un levier clé pour élaborer une réponse unifiée face aux menaces communes. En consolidant une autonomie stratégique, l’Europe pourra mieux défendre ses infrastructures critiques et garantir la sécurité de ses opérations spatiales. Ainsi, protéger les infrastructures et systèmes spatiaux nécessite bien plus qu’une approche classique de cybersécurité. Il est indispensable qu’un Security Operations Center (SOC) soit sensibilisé aux modes opératoires propres au secteur spatial et à ses enjeux. Le spatial n’est pas un secteur comme les autres : toute attaque peut avoir des répercussions stratégiques majeures. La cybersécurité spatiale devient une priorité incontournable, nécessitant non seulement des avancées techniques, mais aussi une sensibilisation accrue des populations et des professionnels du secteur. La sécurisation de l’espace s’impose désormais comme un enjeu majeur, d’autant plus que ce domaine est en pleine expansion et joue un rôle central dans les équilibres géopolitiques contemporains.
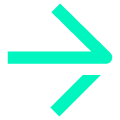
Vers une gouvernance et un cadre réglementaire de la cybersécurité spatiale
Tout comme la terre, la mer et l’air, l’espace et le cyberespace ont progressivement été reconnus comme des théâtres d’opérations militaires dans les stratégies et doctrines de défense.[25] À l’échelle européenne, la politique de cyberdéfense de l’Union Européenne (UE), adoptée en 2018, qualifie explicitement le cyberespace de champ de bataille, affirmant qu’il constitue le « cinquième domaine d’opérations », aux côtés des milieux terrestre, maritime, aérien et spatial.[26] Cette approche est renforcée par la stratégie de 2022, qui intègre désormais l’espace extra-atmosphérique et le cyberespace comme des zones opérationnelles où l’UE affirme sa capacité d’action.[27] En France, la loi de 2008 relative aux opérations spatiales (LOS) constitue le socle de la régulation des activités spatiales.[28] La révision réglementaire, entrée en vigueur le 1er juillet 2024, modernise ce cadre afin de préserver l’attractivité, la sécurité et la durabilité du secteur spatial. Face à l’essor d’acteurs privés, souvent issus du numérique (communication, géolocalisation, etc.), cette évolution réglementaire vise à renforcer la vigilance autour d’une utilisation responsable et sécurisée de l’espace.
Suite à la prise de conscience de l’importance du domaine cyber spatial, l’UE s’est engagée de manière significative en faveur de la cybersécurité. La directive sur la sécurité des réseaux et de l’information (NIS) vise à instaurer un niveau élevé et harmonisé de cybersécurité au sein de l’UE. La directive NIS2, élargit ce cadre à de nouveaux secteurs, y compris le domaine spatial. De plus, la directive sur la résilience des entités critiques prend en compte l’interconnexion croissante des services et vise à renforcer la résilience des infrastructures essentielles en établissant des obligations strictes et en favorisant la coopération internationale. Ces mesures sont complétées par les normes établies dans le Cybersecurity Act, qui met en place un cadre de certification en cybersécurité, ainsi que par le Cyber Resilience Act.[29] Ce dernier impose une approche de cybersécurité par conception, security by design et prévoit des sanctions pour les fabricants en cas de non-conformité.[30]
Dans ce contexte, le cadre juridique européen a évolué pour mieux intégrer les spécificités du secteur spatial. Si la première directive NIS posait les bases d’une cybersécurité harmonisée à l’échelle de l’UE, elle ne reconnaissait pas explicitement le spatial comme un secteur critique. Ceci a été corrigé avec la directive NIS2, qui inclut désormais le secteur spatial parmi les entités essentielles, soumises à des obligations de cybersécurité renforcées. Comme le souligne Laurent Jaffart, ce changement marque une étape clé : les systèmes spatiaux doivent désormais répondre à des exigences plus strictes et formalisées, ce qui contribue à élever le niveau global de sécurité dans l’industrie spatiale européenne.[31]
Le 25 juin 2025, la Commission européenne a présenté l’EU Space Act, une proposition législative visant à harmoniser le cadre réglementaire des activités spatiales dans l’Union Européenne. Ce texte vise à renforcer la sécurité, la résilience et la durabilité environnementale du secteur, tout en stimulant sa compétitivité sur la scène internationale.[32] La proposition repose sur trois piliers : la sécurité, avec des règles pour suivre les objets spatiaux et limiter les débris afin d’assurer un accès sûr à l’espace ; la résilience, via des exigences de cybersécurité pour protéger les infrastructures spatiales et garantir la continuité des activités et la durabilité, en obligeant les opérateurs à réduire leur impact environnemental tout en soutenant l’innovation. Ces règles s’appliquent aux opérateurs européens et non-européens, avec des exigences adaptées à la taille et au risque de chaque acteur, pour un cadre juste et propice à l’innovation.[33]
Celui-ci introduit des exigences strictes en matière de cybersécurité pour les opérateurs satellitaires souhaitant exercer dans l’UE. Fini le simple recours à un chiffrement basique : la loi impose un security by design (Article 76) avec une gestion rigoureuse des risques, une surveillance continue des incidents (Article 83), et un contrôle strict des accès (Article 81). Elle exige également la définition d’une politique cryptographique adaptée à chaque mission spatiale (Article 85), avec des mécanismes robustes garantissant l’authentification et le chiffrement des communications entre satellites et centres au sol (Article 85). Les opérateurs devront aussi réaliser régulièrement des tests d’intrusion pilotés par les menaces (Article 88), former leur personnel aux compétences de cybersécurité (Article 89), et assurer le signalement ainsi que le partage d’informations sur les incidents majeurs (Article 93 et 95). Ces dispositions constituent un tournant majeur, alignant la cybersécurité spatiale européenne sur les meilleures pratiques industrielles, avec des responsabilités légales claires pour les gestionnaires.[34]
Au niveau international, l’OTAN a reconnu le cyberespace comme un domaine opérationnel dès 2016. En 2019, elle a adopté une politique spatiale, dans laquelle l’espace est également considéré comme un domaine opérationnel.[35]
Le traité international prédominant le Droit de l’espace est le Traité de l’espace. Ce traité dispose que les activités spatiales doivent être conformes au droit international, dans le but de maintenir la paix et la sécurité internationale tout en promouvant la coopération entre les nations.[36] Le Droit de l’espace est régi par cinq principaux traités internationaux, regroupant le Traité de l’espace (1967), l’Accord sur le sauvetage des astronautes (1967), la Convention sur la responsabilité spatiale (1971), la Convention sur l’immatriculation (1974) et le Traité sur la Lune (1979). Cependant, ceux-ci restent limités face aux enjeux modernes de cybersécurité. La cybersécurité dans l’espace extra-atmosphérique demeure un domaine complexe et incertain, dans lequel le droit du cyberespace n’est pas entièrement développé, tandis que le droit de l’espace reste lui-même souvent vague et non actualisé. En effet, le Traité de l’Espace et la Convention sur la Responsabilité ont été rédigés bien avant que la cybersécurité et les cyberattaques ne deviennent des préoccupations majeures pour les législateurs et les décideurs politiques. En conséquence, ces traités peuvent rester flou face à la manière de gérer la cybersécurité dans l’espace extra-atmosphérique ni des éventuelles procédures à suivre en cas de cyberattaques.
En revanche, aujourd’hui le cyberespace est également gouverné par la soft law et l’instrument qui nous donne des réponses en matière de « guerre du cyber » est le Manuel de Tallinn relatif à l’applicabilité du Droit International aux opérations cyber.[37] C’est un instrument majeur dans le contexte de l’utilisation de la cybersécurité dans les conflits armés, cependant celui-ci n’est pas contraignant juridiquement et ainsi les Etats n’ont pas l’obligation de suivre les recommandations écrites. Le Manuel de Tallinn dispose que les opérations cyber impliquant des objets spatiaux sont soumises au régime de responsabilité du droit de l’espace.[38] Selon ce manuel, les États « ne doivent pas mener d’opérations cyber qui violent la souveraineté d’un autre État » et « doivent faire preuve de diligence ».[39] Bien qu’ils soient loin d’avoir force de loi, les principes qui pourraient régir la cybersécurité dans l’espace extra-atmosphérique sont énoncés dans le Manuel de Tallinn.
Les domaines du droit numérique et du droit spatial ne s’entrelacent donc pas vraiment, ce qui peut entraîner des lacunes dans l’application de la cybersécurité spatiale. Par exemple, lorsqu’une cyberattaque se produit, les États ne sont tenus que de mettre fin à l’activité nuisible, sans obligation de prendre des mesures préventives. De plus, selon le Traité de l’espace et la Convention sur la responsabilité, c’est l’État victime de la cyberattaque, et non celui d’origine, qui peut être responsable des dommages causés.[40] Un autre problème réside dans le fait que tous les États ne sont pas signataires du Traité de l’espace et de la Convention sur la responsabilité.[41] Enfin, en vertu du droit international, l’obligation de diligence ne s’applique que lorsqu’il y a des « conséquences graves », ce qui peut permettre à certains États d’être exemptés de cette obligation si les cyberattaques ne dépassent pas ce seuil.[42]
La cybersécurité spatiale se trouve à la croisée de deux domaines juridiques complexes et en évolution. Les défis actuels nécessitent une coopération européenne et internationale afin de répondre aux menaces émergentes. Ainsi, la question de la création d’une norme internationale de cybersécurité spécifique à l’industrie aérospatiale, dotée de définitions claires et de principes directeurs, se pose.
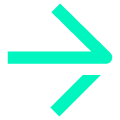
Pour conclure
Défendre nos satellites, c’est défendre notre souveraineté.

Ana GOBILLON
Chargée de mission Affaires Publiques
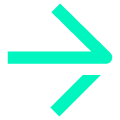
Notes de bas de page
[1] European Space Policy, « ESPI Report 84 – The War in Ukraine from a space cybersecurity perspective » (ESPI, 2022) p2.
[2] « Face à la menace cyber, le spatial s’organise » (CNES, 2025), consulté le 03 juin 2025.
[3] Général Adam pour Brut, « La guerre dans l’espace a-t-elle déjà commencé ? », https://www.youtube.com/watch?v=Ge-PL5Dah1g, 17 juin 2025.
[4] European Space Policy, « ESPI Report 84 – The War in Ukraine from a space cybersecurity perspective » (ESPI, 2022) p2.
[5] Ibid.
[6] « Thales réalise une première mondiale avec la prise de contrôle inédite d’un satellite de démonstration de l’ESA » (Thales, 2023), consulté le 03 juin 2025.
[7] European Space Policy, « ESPI Report 84 – The War in Ukraine from a space cybersecurity perspective » (ESPI, 2022) p3.
[8] Pasco Xavier, « Le nouvel âge spatial : De la Guerre froide au New Space » (2017) CNRS Edition.
[9] EUR-Lex, « Galileo, accès au service public réglementé » consulté le 12 mai 2025.
[10] European Space Policy, « ESPI Report 84 – The War in Ukraine from a space cybersecurity perspective » (ESPI, 2022) p2.
[11] Clémence Poirier, « Understanding Cybersecurity in Outer Space » (ETH Zürich, 2024), consulté le 01 avril 2025.
[12] Ministère des Armées et des anciens combattants, « Point Presse du ministère des Armées du jeudi 3 mars 2025 » (Youtube, 2022), consulté le 01 avril 2025.
[13] European Space Policy, « ESPI Report 84 – The War in Ukraine from a space cybersecurity perspective » (ESPI, 2022).
[14] A Vitard « Il faut repenser la sécurité des infrastructures spatiales de bout en bout » (L’usine Digitale, 2025), consulté le 04 juin 2025.
[15] Island of Palamas case (The Netherlands v United States) [1928] PCA 2 RIAA 829, p838.
[16] Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies (adopted 19 December 1966) RES 2222 (XXI), art II.
[17] Frans Von Der Dunk, « Sovereignty and Space: When and Where Shall the Twain Meet » in Kreijen G and others (eds) State, Sovereignty, and International Governance (Oxford 2002) 462-481, p464.
[18] UN, Charte des Nations Unis (adopté le 26 juin 1945, entrée en vigueur le 24 octobre 1945) 1 UNTS XVI, art 2(1).
[19] Ibid.
[20] Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies (adopted 19 December 1966) RES 2222 (XXI), art I.
[21] Ibid, art VI.
[22] Steven Freeland and Ram S Jakhu, (eds) McGill Manual on International Law Applicable to Military Uses of Outer Space – Volume I – Rules (Montreal Centre for Research in Air and Space Law 2022), Rule 102.
[23] Ibid, Rule 123.
[24] Frans Von Der Dunk, « Sovereignty and Space: When and Where Shall the Twain Meet » in Kreijen G and others (eds) State, Sovereignty, and International Governance (Oxford 2002) 462-481, p464.
[25] European Space Policy, « ESPI Report 84 – The War in Ukraine from a space cybersecurity perspective » (ESPI, 2022) p3.
[26] Ibid.
[27] Council of the European Union, « A Strategic Compass for Security and Defence » (Press Release, 2022) 7371/22, consulté le 02 avril 2025.
[28] Loi n°2008-518 relative aux opérations spatiales (3 juin 2008).
[29] D Febbraro, « The Need for Cyber Resilience of Space Assets: Law and Policy Considerations of Ensuring Cybersecurity in Outer Space » (2023) Canadian Journal of Law and Technology V21 n1, p107.
[30] Ibid.
[31] A Vitard « Il faut repenser la sécurité des infrastructures spatiales de bout en bout » (L’usine Digitale, 2025).
[32] Commission européenne, The EU Space Act (25 juin 2025).
[33] Ibid.
[34] Mathieu Bailly, The EU Space Law is here ! Highlights of its cybersecurity aspects.
[35] North Atlantic Treaty Organization, « NATO’s overarching Space Policy »(2022).
[36] Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and the Other Celestial Bodies (adopté le 19 Decembre 1966) RES 222 (XXI).
[37] D Febbraro, « The Need for Cyber Resilience of Space Assets: Law and Policy Considerations of Ensuring Cybersecurity in Outer Space » (2023) Canadian Journal of Law and Technology V21 n1, p103.
[38] Michael N Schmitt & Liis Vihul, Tallinn Manual 2.0 on the International Law Applicable to Cyber Operations (Cambridge: Cambridge University Press, 2017), 280.
[39] Ibid, 17-27, 30-50.
[40] D Febbraro, « The Need for Cyber Resilience of Space Assets: Law and Policy Considerations of Ensuring Cybersecurity in Outer Space » (2023) Canadian Journal of Law and Technology V21 n1, p104.
[41] Ibid.
[42] Ibid.